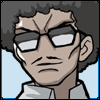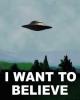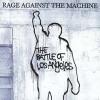Walt Disney révèle ses sources
Les enfants étant réputés aimer les dessins animés en général et ceux de Walt Disney en particulier, c'est une solution commode pour les amuser que de les conduire en voir. On peut imaginer le réflexe des parents et des grands-parents : "Une expo Disney au Grand Palais ? On va y amener les petits, ça les occupera !" Il se pourrait même que la Réunion des musées nationaux (RMN), qui a financé seule et pour 3 millions d'euros l'exposition, spécule sur ce réflexe pour réaliser quelques bénéfices.
Il convient donc de prévenir parents et grands-parents avant qu'ils ne prennent la décision fatale : "Il était une fois Walt Disney" n'est pas une exposition pour les moins de 13 ans. Ou alors seulement pour les moins de 13 ans que passionne l'iconographie du préraphaélisme et du symbolisme et qui ont des connaissances en histoire de l'illustration. Les autres auront du mal à entrer dans les analyses d'images qui constituent le parcours, de comparaison en comparaison. Les très brefs extraits de dessins animés ne suffiront pas à les distraire.
Ce sérieux, qui fait la qualité scientifique de l'exposition, se voit d'autant mieux que la scénographie conçue par l'atelier Mendini est en total désaccord avec lui. Moquettes rouges et vertes, panneaux à découpages en oreilles de Mickey ou en tête de diable, couleurs stridentes et meubles dorés conçus d'après le cercueil de Blanche-Neige : le Grand Palais n'a jamais été paré de manière aussi tape-à-l'oeil. Mais un professeur d'iconographie, même déguisé en Dumbo ou en Capitaine Crochet, reste un professeur d'iconographie. Il cite ses sources, donne des exemples, suggère des généalogies. C'est ce que fait Bruno Girveau, en deux étages et plusieurs centaines de documents.
VOYAGE EN EUROPE
Ceux-ci se divisent entre oeuvres inspiratrices et oeuvres inspirées. Ces dernières, ce sont les esquisses préparatoires, les planches et les séquences que les spécialistes des Studios Disney réalisent à partir des années 1930. Le premier dessin animé à son synchronisé date de 1928 : c'est Steamboat Willie, dans lequel apparaît Mickey. Mais la souris ne tient qu'une place très secondaire dans l'exposition, qui s'intéresse surtout aux adaptations de contes et romans, de Blanche-Neige et les sept nains en 1937 au Livre de la jungle en 1967 en passant par Pinocchio, Cendrillon, Alice au pays des merveilles et Fantasia. Après une brève partie qui traite vite des sources cinématographiques probables des premiers Disney - Murnau, Leni, Lang, Chaplin, King Kong, Frankenstein et le délicieux Gertie le dinosaure de Winsor McCay -, viennent la peinture et l'illustration du XIXe siècle.
En 1935, Disney voyage en Europe et achète des dizaines de livres pour préparer Blanche-Neige : Granville, Rabier ou Doré. Ils servent à ses dessinateurs, émigrants européens pour la plupart et anciens élèves d'écoles des beaux-arts en Suisse, au Danemark ou en Hongrie. Les quelques Américains eux-mêmes ont souvent une formation européenne, à l'instar de Wladimir Tytla, ancien élève du sculpteur Charles Despiau.
Ces données donnent leur assise historique aux rapprochements visuels. La présence d'artistes aussi considérables que Böcklin, Von Stuck, Blake ou Moreau, la "remontée" vers Dürer et Baldung Grien, les allusions répétées aux préraphaélites se justifient donc. Elles rythment d'autant de surprises un parcours qui lasserait s'il n'était qu'une énumération d'études préliminaires et de planches. Degouve de Nuncques, Georges de Feure, Eugène Grasset rappellent l'importance du symbolisme et de l'Art nouveau, qui s'allient à un goût néogothique qui doit plus aux folies architecturales de Louis II de Bavière qu'à Viollet-le-Duc. Füssli et Goya auraient eu leur place ici.
MYTHES ET FABLES ASEPTISÉS
Ces reprises et adaptations tendent systématiquement à l'adoucissement des modèles. Entre les visions de Böcklin ou de Moreau - violentes, érotiques, sanglantes - et ce qu'en font les Studios Disney, l'impératif commercial est passé. Il faut plaire et éviter tragique et scabreux : Charles Perrault et Lewis Carroll passent à la moulinette du puritanisme. Mythes et fables sont aseptisés, comme le dessin Disney lui-même, toujours un peu mou, et les couleurs, qui cherchent la joliesse.
On peut admirer le savoir-faire des spécialistes de la maison, mais il s'exerce aux dépens du sens des textes et des oeuvres qu'il recycle. Il est au service d'une imagerie consensuelle et c'est à la naissance de l'industrie de divertissement que l'on assiste. L'échec de la collaboration entre Dali et Disney autour du projet de Destino en 1946 est significatif : Dali ne parvient pas à être assez peu provocant pour que Disney s'accommode de ses idées et les juge acceptables par son public. Sur la diffusion, sur la puissance de cette industrie imagière et sur ses sous-entendus idéologiques, l'exposition reste cependant très discrète. Le succès planétaire de Disney est pourtant emblématique de la mondialisation par la consommation d'un produit qui ne doit déplaire à personne.
L'ultime salle du Grand Palais, consacrée à quelques reprises des personnages de Disney par l'art, depuis le pop jusqu'à aujourd'hui, est seule à esquisser une réflexion en ce sens. A esquisser, pas plus : les oeuvres choisies ne sont pas les plus virulentes de leurs auteurs - c'est le cas de Lichtenstein, Erro ou Combas - et les plus satiriques - le Bloody Comics, de Rancillac par exemple - ont été oubliées. Toujours pour ne déplaire à personne, sans doute.
"Il était une fois Walt Disney",
Grand Palais, square Jean-Perrin, Paris-8e. Mo Franklin-Roosevelt. Du mercredi au lundi, de 10 heures à 20 heures, mercredi jusqu'à 22 heures. Jusqu'au 15 janvier. 11,30 euros. Catalogue, RMN, 348 p., 45 euros.

 Aide
Aide


 Blue
Blue Green
Green Red
Red Black
Black