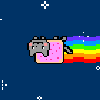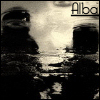Les chiffres de la police surestiment le phénomène des bandes
La focalisation médiatique et politique sur les banlieues tend à surestimer l'importance des affrontements entre bandes des cités populaires. Les statistiques officielles, mises en avant par le ministère de l'intérieur après de violentes rixes dans les quartiers de Pigalle et de la gare du Nord, à Paris, font en effet état de plusieurs centaines de bagarres entre bandes chaque année en France : 435 "affrontements" en 2005, 287 en 2006 et 129 pour les cinq premiers mois de l'année 2007.
Or, selon nos informations, un peu moins de la moitié de ces rixes ont été enregistrées, sur cette période, par la gendarmerie nationale et ne relèvent pas, sauf très rares exceptions, des problématiques de banlieue. La gendarmerie nationale reconnaît ainsi que la plupart des 341 "affrontements" recensés en deux ans dans sa zone de compétence correspondaient, en réalité, à des rixes liées à des fêtes de village ou à des bagarres à la sortie de boîtes de nuit.
Des phénomènes anciens, souvent favorisés ou aggravés par la consommation d'alcool, mais qui n'ont rien à voir avec des violences urbaines : "Tout cela peut démarrer pour des motifs parfaitement futiles : un mauvais regard, le vol d'un téléphone portable, une histoire de filles", remarque l'officier chargé de superviser les données sur les "violences dites urbaines" au sein de la direction générale de la gendarmerie nationale.
A travers son implantation dans quelques villes ou certaines zones périurbaines (Rhône, Oise, Isère, par exemple), la gendarmerie constate certes l'émergence de bandes, au sens de groupes organisés et défendant "leur" territoire, comme à Ezanville (Val-d'Oise), Nangis ou La Ferté-sous-Jouarre (Seine-et-Marne). Mais ces exemples restent exceptionnels dans les régions sous la responsabilité des militaires (qui couvrent 95% du territoire, 50% de la population et 10% des zones urbaines sensibles).
Cette imprécision statistique explique que le Gard apparaisse régulièrement parmi les territoires les plus sensibles. En 2005, par exemple, ce département présentait un nombre plus élevé d'"affrontements entre bandes" que la Seine-Saint-Denis (43 signalements contre 36). "C'est une réalité complètement différente de celle des bandes de cités. Il s'agit essentiellement de bagarres liées à un contexte local, à des fêtes de village très nombreuses. Le tout sur un terrain propice à l'alcoolisme de masse", corrige le colonel Jean-Claude Goyeau, responsable du groupement départemental de la gendarmerie jusqu'en août.
Cette confusion sur le nombre réel d'affrontements entre bandes s'explique par une définition très générale, par le ministère de l'intérieur, de cette catégorie de violences urbaines. Les forces de l'ordre doivent signaler, à leur hiérarchie, tous les "affrontements graves entre bandes structurées ou de circonstance", mais elles ne disposent pas de critères quant à un nombre minimum de participants et à leurs motivations.
Cette difficulté à définir les affrontements entre bandes, et, plus largement, l'ensemble des violences urbaines, a conduit l'Observatoire national de la délinquance (OND) à ne pas valider l'indicateur national des violences urbaines (INVU), créé en 2005 par le ministère de l'intérieur. "De nombreuses questions restent en suspens sur la définition même des violences dites urbaines et sur la mesure de ce phénomène", expliquait l'OND dans son dernier rapport annuel. "Nous n'avons pas validé l'indicateur parce qu'il nous paraît trop instable", note Christophe Soullez, responsable de l'Observatoire, en rappelant que les violences urbaines ne correspondent à aucune incrimination pénale.
"On sait seulement que les phénomènes de bande sont récurrents mais personne n'est capable de les dénombrer précisément", relève Frédéric Ocqueteau, chercheur au CNRS, membre du conseil d'orientation de l'OND. "Le problème, c'est que la notion de bande n'est pas définie, ajoute le criminologue Sébastian Roché. Et qu'on ne sait pas plus à partir de quel moment, de quel seuil, on peut parler d'affrontements." Dans la typologie des violences urbaines, l'indicateur jugé le plus fiable est celui du nombre de véhicules incendiés. Avec des limites considérables : une partie non négligeable des voitures brûlées le sont pour des motifs qui n'ont rien à voir avec des violences urbaines (escroquerie à l'assurance, vols, règlements de comptes, etc.).
La direction générale de la police nationale (DGPN) reconnaît d'ailleurs travailler sur l'élaboration d'un indicateur "plus pertinent" pour tenter de mesurer les violences urbaines. La mise au point d'une nouvelle échelle de mesure ne constituerait qu'un nouvel épisode dans la bataille du thermomètre : depuis 1991, et l'invention de la première échelle de mesure des violences urbaines par les Renseignements généraux, pas moins de quatre indicateurs différents ont été utilisés, rendant impossibles les comparaisons sur le long terme.
Ennuyeux, ennuyeux.
Encore plus que les commentaires des articles du monde sur les affrontements place Pigale où des types se prétendant boutiquiers professaient que les rapports et les articles exagéraient grossièrement la réalité.
 Aide
Aide


 Blue
Blue Green
Green Red
Red Black
Black